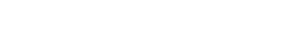Elle est rapidement devenue omniprésente. L’appellation de « musique urbaine » s’est imposée parmi les médias généralistes, puis chez les professionnels de la musique, pour finir par être employée par les rédacteurs spécialisés sans broncher. Un terme englobant, qui permet de réunir dans un semblant de famille musicale la soul, le R&B, le rap et leurs multiples dérivés. A l’inverse de genres facilement étiquetables, la musique urbaine ou plutôt les musiques urbaines ont en effet tendance à être en évolution constante depuis maintenant près d’un-demi siècle, ce qui explique qu’elles soient aussi difficiles à appréhender pour des auditeurs qui y restent hermétiques. Et si, en employant ce terme généraliste, fourre-tout et finalement très pratique, le rap avait joué le jeu de ses détracteurs en adoptant en toute connaissance de cause une dénomination réductrice et négativement connotée ? C’est en tout cas le sentiment qui est exprimé par plusieurs membres de l’industrie musicale. Alors que certains d’entre eux ont vu ce terme s’accoler à leur fonction – ç’a été le cas pour Wendy Goldstein (Republic) ou encore Joie Manda (Interscope Geffen A&M) – d’autres s’élèvent contre une qualification jugée imprécise. Sam Taylor, actuel vice-président de Kobalt, ayant par le passé travaillé pour EMI où il a notamment signé Pharrell Williams, proteste contre un terme qui évoquerait quelque chose « à faible revenu, pas sûr », autrement dit précaire. Il n’est pas le seul : DJ Semtex, le célèbre intervieweur et présentateur britannique pense de la musique urbaine qu’elle est une « paresseuse, imprécise généralisation de plusieurs formes d’art culturellement riches » ; Sonia Diwan, collaboratrice du label Sound Advice LLP, rajoute que la musique urbaine est « pop, de la musique populaire » et que « la labelliser urbaine est un terme inapproprié ». Effectivement, le rap gagne chaque année des parts de marché et s’impose comme un style de musique plus populaire que jamais. Le cantonner à de la musique de rue est une grossière erreur. Le rap s’est d’ores et déjà imposé comme un standard culturel pour plusieurs générations, à tel point qu’il s’est aujourd’hui fractionné en micro-scènes dont les publics ne sont pas toujours reliés. Depuis longtemps déjà, le succès du rap a dépassé le cadre des quartiers populaires pour aller toucher un public bien plus large. Surtout, les moyens financiers mis en oeuvre pour la réalisation de certains albums, comme récemment le blockbuster ASTROWORLD de Travis Scott, montrent à quel point le rap s’est adapté à son succès et s’est professionnalisé, à l’instar de ses pairs. Si l’appellation de musique urbaine a été plus pertinente par le passé, elle apparaît aujourd’hui désuète mais toutefois très ancrée dans le vocabulaire de l’industrie musicale. Mal à l’aise avec ce terme, Sam Taylor n’est néanmoins pas dupe : tout le monde n’utilise pas ce terme à des fins contemptrices ou réductrices. « Est-ce un raccourci pour ne pas dire hip-hop et R&B ? Oui. Mais, pensons à un autre terme ». Quelles alternatives ? La première serait de reconnaître l’apport fondamental à chacun de ces genres des communautés d’afro-descendants, et donc de parler de « musiques noires ». La seconde serait de reconnaitre que le rap, la funk, la soul et le R&B ont fini par emprunter des chemins bien différents les uns des autres, et que s’ils ne sont pas dénués d’interconnections, ces genres n’ont plus assez de dénominateurs communs pour être regroupés sous la même appellation du strict point de vue musical. D’ailleurs, le gospel, le rythm & blues et le jazz ont depuis longtemps été exclus de cette famille finalement assez artificielle, et ce alors même qu’ils en sont le socle fondateur et qu’ils n’ont jamais totalement cessé d’entretenir des liens particuliers avec elle…
Changerz, le duo atypique qui veut gommer les frontières du rap français