Historiquement, Polydor était un label de musique français mais depuis quelques années cette division d’Universal Music a pénétré un nouveau secteur, le rap. En l’espace de quatre années, Polydor a rencontré de nombreux succès sur l’urbain, de Nekfeu à Dadju en passant par Big Flo & Oli, prouvant l’éclectisme du label. Afin de revenir sur ces réussites ainsi que le virage entrepris par le label, nous sommes partis à la rencontre d’une personnalité bien connue de l’industrie, à savoir Pauline Raignault, responsable du marketing avec une focale sur les musiques urbaines. Au détour, d’un entretien fleuve, nous avons pu revenir sur l’ensemble des actualités du label, l’avenir des artistes en développement, le maintien du succès des têtes d’affiches de Polydor, et son image particulière.
HHR : La force qu’a acquis Polydor dans le rap français est-elle liée à une volonté de virage urbain de la part d’Universal Music France ?
Pauline : C’est plus une volonté de Polydor que d’Universal. Le directeur du label de l’époque, Christophe Lameignère, s’est rendu compte que l’urbain était en train de gagner en visibilité. Le premier directeur artistique de Polydor à avoir signé du rap, c’est Jérôme Labory avec 1995. Je ne compte pas MC Solaar là-dedans, qui était déjà sous contrat dans les années 90.
HHR : De 1995 à Dadju en passant par Bigflo & Oli, est-ce que Polydor ambitionne d’offrir un panorama de la diversité du genre ?
Pauline : Oui, c’est volontaire, et c’est un panorama qu’on ne retrouve pas dans beaucoup d’autres labels. Polydor était initialement connu comme une référence sur la musique française type Maurane, Eddie Mitchell, Calogero… Des artistes qui n’avaient strictement rien à voire avec le paysage urbain. Ça avait peu de sens pour Polydor de partir dans des signatures trop « street » ; ce type de rap nécessite d’avoir des acteurs spécialisés, étant donné qu’il implique un mode de fonctionnement particulier. Polydor s’est dit que ça pouvait être intéressant de commencer par de l’urbain, mais de l’urbain accessible à un public relativement large. D’ailleurs, il était intéressant de commencer avec 1995 pour cette raison. Je connaissais personnellement ce groupe par mon ancien poste chez Goom Radio, et eux-mêmes m’ont dit avoir choisi Polydor parce qu’il n’y avait pas de rap dans le roster. Ils savaient qu’ils seraient considérés de façon incomparable à ce que pouvait offrir un label qui aurait déjà signé d’autres rappeurs.
HHR : Cette image de place forte de la musique française, c’est encore quelque chose qui attire les artistes aujourd’hui ?
Pauline : Je suis arrivée en 2015 au sein de ce label et l’un des objectifs était d’étendre le catalogue urbain, mais il fallait une personne ayant une crédibilité et en qui les artistes pouvaient avoir confiance. Personnellement, j’ai toujours travaillé de cette manière, en étant au service des artistes coûte que coûte, bien que je sois payée par la maison de disques. Un peu comme un manager, je vais très souvent être à leurs côtés, quitte à me faire taper sur les doigts par mes patrons qui estiment que je les défends trop parfois. D’ailleurs, je pense que c’est la raison pour laquelle ils ont envie de travailler avec moi. Ça fait trois ans que je suis chez Polydor, et j’ai vu trois patrons passer : je suis arrivé sous l’ère Eric Lelièvre, ensuite est venu Julien Creuzard, qui chapeautait Capitol en même temps, et depuis deux ans et demi c’est Stéphane Espinosa. En voyant défiler ces différentes personnalités, je me rends compte que je réussis à tirer les patrons de label vers un côté humain, sans les détacher complètement de l’aspect financier car c’est une industrie, mais en les rapprochant de leur sensibilité artistique.
HHR : Finalement, tu ne trouves pas qu’il y a un ADN commun entre tous les artistes que vous avez signés malgré leur apparente diversité ?
Pauline : Je suis totalement d’accord, il y a un dénominateur commun entre tous les artistes. Depuis quatre mois, j’ai effectué un gros recrutement qui montre la nouvelle voix vers laquelle on veut s’étendre. J’ai recruté Screetch, Khaleel et Nath, trois personnes sur le terrain depuis plus de dix années. Screetch est notamment le co-fondateur de Daymolition, une plateforme qui a fait émerger les plus grands d’aujourd’hui. C’est des gens humains, avec qui on partage exactement les mêmes valeurs éthiques… Donc je trouve ça normal d’être en mesure de leur proposer un véritable emploi avec un salaire fixe, pour toute leur expertise. Via cette cellule, on va tendre à développer des signatures plus spécialisées.
HHR : Il va donc y avoir un véritable enjeu autour de la première signature spécialisée du label…
Pauline : La priorité est de faire une bonne signature, de ne pas se tromper. Quelque part quand tu fais un recrutement pouvant susciter l’intérêt d’autres labels, tu sais qu’il y aura beaucoup de curiosité et qu’on sera attendus au tournant. Peut-être qu’on prendra du temps, il y aura un enjeu particulier sur cette signature un peu plus « street » chez Polydor.
HHR : Ces derniers mois, Polydor a annoncé un certain nombre de certifications… C’est encore un enjeu pour les équipes ?
Pauline : Pour le label, oui, c’est toujours très impactant car cela permet aux équipes promos de défendre plus facilement les projets en radio et en TV, notamment en annonçant toutes les certifications. En général, le bon attire le bon, c’est un cercle vertueux qui se crée. Pour le label, c’est comme un trophée, on y attache encore beaucoup d’importance. Pour ma part, ce qui m’importe c’est de faire une sortie juste, et qu’il y ait un bon dosage entre le marketing et la personnalité de l’artiste. Si l’artiste est fier, je suis satisfaite. Au sein de ma carrière, il y a eu trois sorties qui ont été très importantes pour Polydor. La première, c’est la sortie de Maestro de Lartiste. Sincèrement, si je n’avais pas été là, il n’aurait pas rendu les bandes de son album tellement ça partait en conflit entre le label et lui. Il fallait un trait d’union, parfois à coups de pleurs et d’énervement mais aujourd’hui c’est un album qui a été certifié disque de platine. Actuellement, en voyant où en est Lartiste, je ne peux qu’être fière pour lui car c’est un mec qui mérite vraiment. La deuxième sortie dont je suis fière, c’est Cyborg, pour lequel on a fait un lancement historique à Bercy. On a été les premiers à effectuer un système d’envoi de textos en direct, avec des données CRM, on a envoyé plus de 3000 textos. On a réussi à conserver cette sortie très secrète alors que tout le monde me disait que je n’y arriverai pas. La troisième, c’est Disiz avec Pacifique. C’est un album dans lequel j’étais très impliquée et l’artiste est formidable car il est à l’écoute. L’idée de faire une pochette d’album avec une vague qui s’anime, c’est le genre de détails qui nous fait dire qu’on propose des produits vraiment qualitatifs. Tout le repositionnement visuel effectué autour de Disiz se matérialise par presque 50.000 exemplaires écoulés… Alors qu’il n’a plus été certifié depuis Poisson Rouge.
HHR : Sur le physique, Polydor essaye toujours d’amener une plus-value, c’est motivé par des considérations financières ou par la volonté de proposer un objet différent ?
Pauline : Les deux ! En plus, en étant dans la musique, je vois pas l’intérêt d’acheter un album cristal classique. C’est tellement facile d’allumer son téléphone et de consommer sur Spotify… Pour moi, le consommateur idéal est celui qui va se déplacer pour acheter le disque et avoir l’objet collector avec des titres inédits puis l’écouter sur les plateformes de streaming au quotidien. Pour Disizilla par exemple, on a prévu un boitier vert fluo. Il sera uniquement appliqué aux 15.000 premiers exemplaires tirés, tout le reste sera du chaînage classique transparent. Pour celui-ci, on va sortir le vinyle en même temps. Le vinyle, c’est encore une autre consommation. C’est parfois même considéré comme un objet d’art et ça génère un chiffre d’affaires supplémentaire.
HHR : A l’inverse, vous avez plus axé la promotion de Dadju sur le streaming, par exemple en sortant de nouveau clips pour placer les morceaux en playlist.
Pauline : Sur Dadju, on est à plus de 450.000 ventes à l’heure actuelle, c’est exceptionnel pour un premier projet. Surtout que je connais l’artiste depuis l’époque de Shin Sekaï, par le biais de Wati-B et Daymolition. Pour le coup, je suis très transparente, je trouve qu’il a limite sorti trop de clips. Tout dépend de la typologie du contrat avec l’artiste. Nous avons un contrat de licence avec Dadju, et cette stratégie vient plus de lui et de ses producteurs et managers qui sont à fond sur le streaming. L’action que j’ai eu là-dessus a été de les driver, en leur disant « ça cartonne en streaming, comment on fait pour améliorer nos ventes physiques » ? Parfois dans le rap, il va y avoir des ventes très faibles en physique et en digital mais d’énormes scores en streaming. Je trouve que c’est un peu complexe car le physique est mal travaillé. Cependant, il ne faut pas oublier que le premier gros single de Dadju, Reine, a démarré sur Instagram et qu’on l’a signé une semaine après la sortie du clip. Il faut respecter le cycle naturel d’un artiste, quand il se fait connaître sur internet tu sais que ta consommation va beaucoup se passer dessus par la suite.
HHR : Je trouve qu’il y a eu une différence dans la qualité des clips. Reine était bien, suivent trois clips qui n’étaient pas mauvais mais pas incroyables… C’est à partir de Sous Contrôle que le grain était différent et davantage qualitatif.
Pauline : Notre implication a commencé à partir de Gentleman 2.0, mais le budget était différent surtout.
HHR : Finalement, il a sorti beaucoup de clips mais cette évolution visuelle est l’une des raisons expliquant son succès six mois après la sortie…
Pauline : Ce que j’aime bien dans notre stratégie, c’est qu’on a réussi à switcher de single en single avant que ça se casse la gueule. Il y avait de la matière aussi, parce que sur un premier album, on a treize titres certifiés dont deux single de diamant. J’ai jamais travaillé sur un projet qui a obtenu autant de récompenses, c’est une première. Le mérite revient en premier lieu à l’artiste qui fournit une matière à exploiter.
HHR : Au regard du mode de calcul du Snep, qui consiste à diviser par deux les écoutes du titre le plus streamé d’un album, l’idéal est d’en avoir au moins un deuxième au même niveau d’audience ?
Pauline : Totalement, c’est la différence entre des Gims, Dadju qui sont des hitmakers et des artistes comme Dosseh, dont j’adore la musique mais qui a seulement Habitué qui explose tout. Niska était un peu dans ce cas, mais a réussi à rebondir avec Salé et ce titre a fait la différence. En tant que professionnels de l’industrie, on est là pour aider les artistes en leur conseillant d’avoir trois singles potentiels par album qui pourront s’enchaîner correctement.
HHR : Ce dont tu parles c’est du travail de studio en amont de la sortie, c’est à partir de cette étape que vous avez récupéré l’album de Dadju ?
Pauline : Il est arrivé avec son projet parce que c’est une licence, mais lui ne calcule pas, c’est un hitmaker. On vient de sortir une réédition de dix titres de son album, soit dix singles potentiels. Evidemment, l’objectif est d’atteindre le disque de diamant, mais Dadju est surtout un artiste avec qui j’adore travailler parce que quand tu associes les idées, la créativité, les envies des artistes et les exigences du management, c’est le plus bel exemple de réussite.
HHR : Prioriser le développement sur le long terme, c’est mettre un point d’honneur à ne pas signer le « buzz du moment » ?
Pauline : Il y a quand même eu des buzz sur lesquels on s’est positionnés. Par exemple, un directeur artistique de chez nous s’était positionné sur Moha La Squale en premier. C’est le côté de la musique que j’aime le moins, ça devient une course aux enchères. A un moment donné, pourquoi t’engager financièrement sur un artiste qui n’a pas encore enregistré son premier son studio ? C’est difficile comme pari si tu y vas en tant que label : est-ce que t’es convaincu par l’artiste ou est-ce que tu veux montrer que t’as des plus grosses cornes que les autres ?
HHR : Concrètement, quelle place occupe le label au niveau du managements et de la direction artistique ?
Pauline : Ça dépend, certains artistes ont des managers, d’autres n’en ont pas, et en fonction de ça notre rôle va être différent. C’est vraiment du cas par cas, je suis plutôt connue pour leur dire les choses telles qu’elles sont afin qu’ils ne soient pas déçus. Quand j’aime vraiment pas un son, une idée ou un comportement je leur dis, idem quand j’aime bien, mais c’est toujours eux qui auront le dernier mot. Dans tous les cas, j’ai l’esprit libre en me disant j’ai été capable de les prévenir.
HHR : Vous leur fixez des objectifs commerciaux ou artistiques ?
Pauline : Franchement, aucun. On leur donne nos estimations — « on pense faire tant » — mais il n’y a pas d’objectifs posés et précis.
HHR : On sait que certains artistes ont des budgets vestimentaires notamment, mais comment se passe et jusqu’où peut aller ce travail sur l’image ?
Pauline : Ça peut aller loin ! Je vais donner un exemple qui n’est pas chez Polydor, sur Diam’s. C’est grâce aux gens qui l’entouraient qu’elle a fait une coupe à la garçonne et qu’elle a mis des anneaux aux oreilles, ce qui donne tout de suite un visuel très reconnaissable et identifiable. Il y a beaucoup de rendez-vous effectués sur ces sujets avec des artistes. Récemment Kobo, un artiste signé chez nous, voulait enlever son masque et on lui a fortement recommandé de le garder parce qu’il lui donne un charisme supplémentaire et un côté mystérieux, ça crée un vrai personnage. Ça lui permet aussi de vivre sa vie de tous les jours sans être reconnu, comme Maître Gims sans ses lunettes.
HHR : D’ailleurs qu’est-ce que tu penses de cette vague de rappeurs masqués ? Est-ce que c’est une forme d’aboutissement du côté « théâtral » du rap ?
Pauline : Je ne sais pas si ça donne vraiment un côté théâtral, ce qui est sûr c’est qu’ils ont pu le faire parce qu’il y a une démocratisation de l’urbain. Plus tu étends la palette, plus tu peux te permettre des choses. D’un autre côté, Siboy, quand il enlève sa cagoule, il a une tête de nounours. Tu peux pas chanter des trucs aussi hardcore avec une tête si gentille, je trouve que la cagoule lui va très bien. T’as surtout ce côté de pouvoir préserver ton identité, passer de star à anonyme en enlevant juste une cagoule. Ça peut freiner certains médias mais est-ce que ce sont des médias sur lesquels ils iront ? Pas forcément. Le plus important est de rester qui on est et de choisir la manière dont on a envie de se présenter au public, cagoulé ou pas.
HHR : Qu’est ce qui explique les succès à répétition de l’écurie urbaine de Polydor ?
Pauline : Je dirais qu’on a encore pas mal de choses à prouver, notamment sur nos développements, mais qu’on écoute déjà beaucoup les artistes et qu’on apporte notre touche de professionnalisme pour les aider à aller jusqu’où ils veulent sans se précipiter. Notamment en allant construire l’artiste dans le moindre détail. Notre vision sur le long terme est importante mais c’est du sur mesure, on ne peut pas dupliquer des stratégies et il faut vraiment le prendre dans ses entrailles. C’est là où tu peux ressortir le plus d’idées innovantes, ingénieuses et créatives.
HHR : Planifier la sortie d’un album, j’imagine que ça passe aussi pas une écoute intensive pour repérer tous les éléments essentiels ?
Pauline : C’est un procédé qui se fait en amont. La stratégie on l’écrit en global, avant la sortie des projets, et dès qu’ils sont sortis, on peut réajuster en fonction de la vitesse à laquelle les titres prennent ou pas. Par exemple, pour Disiz, on a fait beaucoup de rendez-vous en interne, des écoutes en avant-première en province et je me déplace sur toutes les dates. Plus t’écoutes le projet, plus t’as des idées qui se dessinent et mûrissent ou évoluent.
HHR : J’ai l’impression que la province est un territoire important pour Polydor, ce qui explique notamment le travail avec Bigflo & Oli et VSO…
Pauline : Le bassin d’acheteurs d’Île-de-France est limité, si on est capables d’avoir des artistes qui parlent à la France entière c’est magnifique. Après, les développements sont plus longs quand t’es établi à l’échelle locale : t’as un vivier, tu tapes dessus, ça sort, tu fais tes scores tranquille. Ce qui est intéressant reste de passer au-delà de ta zone régionale, on prend beaucoup de temps pour sonder la France entière.
Interview : VSO, le groupe nîmois qui veut sa place au soleil
HHR : La série de succès urbains dont on a déjà parlé a installé la réputation de Polydor dans le rap français. Le plus dur n’est-il pas à venir ?
Pauline : C’est vrai, et pourtant bizarrement j’ai pas cette impression de « label à réussites ». C’est compliqué d’avoir le temps de prendre du recul, j’ai tout le temps la tête dans le guidon. Actuellement, j’ai au moins une sortie importante par mois, donc je vais m’arracher et m’impliquer à fond. Il y a beaucoup de développements qui vont arriver et j’espère des nouvelles signatures. Tu sors un album, t’enchaînes, pareil pour le deuxième, tu ne t’en rends même plus compte à la fin.
HHR : Finalement, c’est presque plus difficile de gérer un artiste en développement parce que ses premiers clips et ses premières sorties seront déterminants.
Pauline : C’est pour cette raison qu’il y a finalement peu de développement en maison de disque, parce que c’est un investissement humain et financier sur la durée. Quand t’es rappelé à l’ordre au niveau de l’argent, t’y réfléchis à deux fois. C’est pour cette raison que Polydor est intéressant, avec nos grosses marques on génère des chiffres d’affaires conséquents qui permettent de réinvestir sur du développement. Il faut avoir les reins solides pour se le permettre.
HHR : Tu parlais du développement à l’échelle locale. En urbain, c’est vraiment différent. Maître Gims fonctionne bien parce que sa musique s’intègre partout mais pour beaucoup il y a une différentiation très marquée, sur Lyon, Paris, Marseille, le Sud-Ouest, qui ont leurs propres identités musicales, leurs propres modes de consommation et leurs attentes. C’est plus difficile de sortir de sa région dans le rap que dans un autre genre musical…
Pauline : J’aurais tendance à penser que c’est plus difficile pour un rappeur de province de s’étendre dans toute la France.
HHR : Par exemple Naps est extrêmement populaire à Marseille mais beaucoup moins à Paris. C’est difficile de s’affranchir de certaines contraintes locales.
Pauline : Big Flo & Oli, qui viennent du Sud-Ouest, je pense que c’est justement leur position qui a fait que ça a pris autant. Ils sont atypiques et ils rappent pour les gens qui n’écoutent pas que du rap. Là où je les trouve fort, c’est qu’ils sauront faire des grandes piqûres de rappel de temps en temps, notamment dans Rentre dans le cercle. D’ailleurs, c’est moi qui les ai poussé à passer dans le programme, ils n’étaient pas chauds de base. Finalement, cela leur a fait un bien fou, ça les a rétablis en tant que kickeurs. Avant eux, il y avait peut-être Orelsan qui rappait pour les gens qui n’écoutent pas que du rap, mais aussi pour la province. Quand tu viens de province, tu comprends directement de quoi ils parlent. Par exemple, Défaite de famille, j’ai vraiment eu l’impression qu’il parlait de ma famille. Il y a comme ça quelques grands thèmes communs presque uniquement réservés aux provinciaux. Peu de gens le savent, mais je viens de Châteauroux dans l’Indre. Difficile de faire mieux côté province (rires).

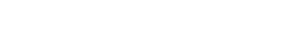








Comments 2