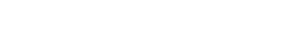« Dis-leur de casser la gueule aux dealeurs qui dans l’ombre attendent leur heure » c’est avec ce conseil musclé que Gainsbarre s’adressait « aux enfants de la chance qui n’ont jamais connu les transes des shoots et du shit ». Et Dieu sait que le bonhomme devait en connaitre un rayon sur la consommation de substances illicites… En 1995, c’est aux autres, ceux qui leur ressemblent, à savoir les enfants de la malchance que les membres d’Expression Direkt décident de s’adresser quand ils débarquent en plaçant Dealer pour survivre sur la BO du film qui synthétise le malaise de toute une génération : La Haine. Sorti tout droit de Mantes la Jolie, à 60 km d’un milieu hip hop parisien encore trop hermétique et élitiste, c’est avec ce morceau phare que le groupe va réaliser une véritable OPA sur un genre encore en pleine gestation : le rap français. Il faut dire que jusqu’ici ce dernier même s’il parle de la rue, il ne parle pas encore vraiment à la rue.
➡ Expression Direkt, quand le rap français trouve enfin son chemin jusqu’aux oreilles des banlieues
Pour remettre les choses dans leur contexte, il est bon de rappeler que c’est le moment où des groupes comme La Cliqua, 2Bal 2Neg’ ou encore les Sages Po balancent leurs premiers projets discographiques. Malgré l’indéniable qualité des productions de l’époque, les banlieusards regardent souvent avec dédain et moquerie ces gens qui se revendiquent des valeurs de la Zulu Nation, portent des sacs à dos sur scène et mettent des pantalons trop larges. Trop influencé par la scène New-Yorkaise, et donc très éloigné des préoccupations de la banlieue française, le rap n’a pas encore la côte dans les cités. Festifs et en oppositions avec le coté faussement rebelle du rock et petit bourgeois de la pop, qui sont la norme dans les autres sphères de la société française auxquelles la jeunesse des banlieues ne s’identifie pas, c’est la Funk, et dans une moindre mesure le Raï, qui sont majoritairement plébiscité dans les quartiers. Au feu rouge, ce sont les hits d’artistes comme Roger Troutman, Cheb Mami ou encore James Brown qui sont crachés par les boomers des Golfs VR6 ou du dernier Merco. Par ailleurs, bien que plusieurs rappeurs de l’époque aient essayé d’aborder le sujet de la vente de drogue, les morceaux n’ont pas forcément trouvé beaucoup d’écho, souvent jugés trop moralisateur (cf. IAM Le sachet blanc). Donc quand Express D arrive, son morceau va avoir l’effet d’un électrochoc dans le rap français. Il va avoir pour effet de contribuer à démocratiser un style musical qui était jusqu’ici cantonné à une niche et dont la plupart des auditeurs étaient surtout des passionnés maîtrisant parfaitement les codes du genre.

Avec Dealer pour survivre, le groupe veut s’adresser directement à la population de quartiers, les grands oubliés du rap français jusque là. Et le pari est pleinement réussi tant au niveau du fond que de la forme. Introduit par un sample de Kassav et avec une instrumentale très influencée par la G-Funk californienne alors à son avènement, Weedy, Kertra, Judy, Le T.I.N et Delta retranscrivent leur débrouille en rimes. Sans faire l’apologie de la vente de drogues et sans tomber non plus dans les fantasmes liés au grandes figures du narcotrafic qu’on peut retrouver dans le rap français actuel,Express D présente le choix du deal comme une fatalité pour la jeunesse banlieusarde (« Avec toute une mi-fa en lère-ga dans une té-ci, job après job, j’ai pointé ANPE, je n’ai pas le profil type pour rentrer chez eux »). Ils n’en font pas la promotion mais au contraire déplorent le fait de devoir laisser leurs valeurs morales de coté pour pouvoir s’adonner à cette activité. La seule qui, au vu de leur situation, leur permette de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles.
Il est indéniable que le succès du morceau est dû en grande partie à l’aspect très groovy de l’instru, au refrain exceptionnel de Judy, ainsi qu’aux performances vocales des autres membres du groupe et plus particulièrement de Weedy. Il faut dire qu’à l’époque les refrains chantés et le rap mélodieux ne sont vraiment pas la norme et sont quasi considérés comme blasphématoires dans un rap français rigide qui sort à peine de l’affrontement binaire entre supporters d’IAM et d’NTM. Ajouté à cela le style vestimentaire 3/4 Costla des scar-las, l’emploi de l’argot de banlieue et du verlan, et on peut être sûr que les tenants du hip-hop francophone de l’époque ont du voir arriver les membres d’Express D comme des extraterrestres. Toutefois au delà de l’aspect chantant et dansant du track, il est sur que ce qui explique en grande partie son succès c’est le fait qu’on a un enfin un morceau qui parle directement à toute une frange de la population française qui était encore largement ignorés par les rappeurs français, à savoir les mecs de cité. Enfin du rap de fils d’immigré qui traite des problématiques qu’ils rencontrent dans leur quotidien. Jusqu’ici le rap français avait été une sous-culture d’élite qui nécessitait de dominer les règles du genre pour pouvoir en apprécier pleinement les textes et la musicalité. Avec ce morceau, Express D a contribué à populariser le rap dans les banlieues et a ouvert la voie à d’autres groupes nés dans leur giron et dont la Mafia K’1 Fry est l’exemple le plus criant. On pouvait maintenant rapper ou écouter du rap sans passer pour un bouffon, un « américain » ou les deux à la fois.
➡ La banalisation de la figure du vendeur de drogue, une empreinte durable dans le paysage musical du rap
À partir de là, la figure du dealeur de drogue va s’inscrire de manière durable dans le paysage rapologique français. Contrairement à celles du Pimp ou du Player, qui sont également issues de la culture rap américaine et de la réalité des ghettos des Etats-Unis mais n’ont jamais réussi à traverser l’Atlantique parce que jugées trop lointaines de la réalité française, celle du Drug Dealer va trouver un terrain fertile dans les territoires oubliés de la République puisqu’elle entre en corrélation avec un certain mode de vie. Dealer pour survivre, rarement titre n’aura été aussi explicite. Cette devise pourrait être considéré comme le pendant français du fameux Get Rich or Die Tryin si cher à 50 Cent. Suite à ce morceau, on va retrouver le vendeur de drogue de manière récurrente dans les morceaux de rap français, que cela soit sous forme de fiction comme dans le très bon Pucc Fiction (1997) d’Oxmo Puccino (« En cas de doute, planque la coke dans le cockpit »), ou de façon plus concrète et sombre comme dans les écrits de Lunatic (« Y’a pas besoin d’avoir fait Math’ Sup’ pour savoir couper un ze-dou » dans Les vrais savent – 1997).
Mais avec le temps cette figure va peu à peu évoluer en parallèle à la dégradation des conditions vie dans les banlieues et au recours de plus en plus important aux trafics de substances illicites. Les rappeurs, qui à la base racontaient la vie des dealeurs dans leur storytelling, vont peu à peu se mettre à rapper comme s’ils étaient eux-mêmes des dealeurs de drogues. Par ailleurs, la vente de drogues dures va devenir de moins en moins taboue dans le rap français comme l’illustre ces deux phases de Booba qui en 2003 rappait sur un feat avec Rim’K « Ramène de la beuh ou casse toi! Viens pas vendre ta came ici » (Banlieue) alors qu’il affirmera en 2007 « C’est nous qui la vendons c’est toi qui la sniffe » (Du Biff). Pour faire un bref historique sur le sujet, on peut affirmer sans trop se tromper que la vente de drogues dures était très mal vue dans les quartiers des années 90.
À l’époque les dealeurs qui officiaient en banlieue le faisaient en général en toute discrétion sous peine de se faire violemment prendre à partie par certains habitants. De nombreux banlieusard voyaient d’un très mauvais œil cette activité étant donné qu’ils considéraient à juste titre que les revendeurs étaient les responsables directs de la mort de proches ou de « grands frères » ayant succombé aux sirènes de la seringue et de la cuillère. L’héroïne et par la suite le crack ont fait des ravages dans certains quartiers. Toutefois, influence du rap américain aidant, la figure du dealeur de drogue va de plus en plus se banaliser dans le rap français et les banlieues jusqu’au point d’obtenir pignon sur rue au tournant des années 2000, et même de devenir une position enviable et respectée par beaucoup. D’ailleurs, Rohff résumera très bien cet état de fait en faisant le triste constat qu’il vient du « temps où les dealeurs de cames se faisait chasser jour et nuit » mais que « les mêmes qui leurs faisait la guerre, la revendent aujourd’hui » (Repris de Justesse – 2008).
➡ Le spleen du vendeur, une musique en perpétuelle évolution pour illustrer un problème éternel
Alors que des mots comme « charbonner » ou « four » reviennent de façon de plus en plus récurrente dans la bouche des rappeurs français dans la période allant de 2005 à la moitié des années 2010, la nouvelle génération va alors reprendre à son compte la figure du dealeur de drogue. Mais cette fois, c’est pour en chanter le spleen. PNL en est le cas le plus probant. Comme pour Express D, nulle question pour eux de faire l’apologie de la vente de drogues. Il s’agit plutôt de se résigner au fait que dans la plupart des cas c’est la seule porte de sortie de la misère pour les populations qui vivent à l’ombre des grands bâtiments de bétons. Près de deux décennies après la sortie du morceau d’Express D, on est toujours bloqué dans la même l’impasse. Il est par ailleurs assez troublant de constater que quand Ademo rappe « c’est sale quand j’vends la came mais bon, croyez pas qu’j’kiffe, des remords quand j’suis à table » sur Oh Lala (2015), sa phase renvoie directement à celle du T.I N quand il affirmait que « ceux qui disent de moi que je ne fais aucun effort comprennent que donner de l’argent sale à ma mère me remplit de remords ». Ce genre de constatation présente clairement l’échec des pouvoirs publics et autres politiques à tenir leurs promesses : le fameux plan Marshall des banlieues n’a jamais eu lieu.
Par contre à l’inverse d’Express D qui ne parlait qu’au quartier, la figure du dealer de drogue présente dans le rap de PNL va désormais toucher toutes les strates de la société française. La consommation de cocaïne étant dorénavant rentré dans les mœurs chez tout un pan de la jeunesse, il n’y a donc plus aucun tabou à affirmer haut et fort qu’on deale la blanche. D’ailleurs les ien-cli comme Hervé ne sont plus de simples toxicomanes détruit par le crack mais également une partie des consommateurs de rap. Malgré les avertissements de certains anciens comme Kery James, qui avec des morceaux tels que La poudre aux yeux (2009) dénonce la perversité du cercle vicieux de la consommation et de la vente de cocaïne, le vers est déjà dans le fruit.
Aujourd’hui des artistes comme Maes, Kekra ou 13 Block revendiquent à fond leur position de charbonneurs qui rappent. Que ce statut soit réel ou mis en scène, cela nous en dit long sur l’urgence de la situation dans les quartiers dont le rap est depuis longtemps le haut parleur. À la différence de leurs ainés qui ne voyaient que dans le deal de shit un moyen pour s’en sortir, avec la nouvelle génération, on a l’impression que la vente de drogues dure est devenue une fin en soi. En effet ils paraissent s’être résignés à devoir en passer par là pour pouvoir atteindre leurs rêves d’indépendance financière et accéder enfin au pouvoir d’achat. Ils n’en tirent aucune gloire mais font le sombre constat que la vente drogue est la seule alternative face à un avenir bouché. Le paradoxe c’est qu’ils font cela tout en omettant le fait que cette activité entre souvent en opposition fondamentale avec les valeurs morales ou religieuses que leur parent leur ont inculqués, bien que cela soit évoqué par certains comme c’est le cas pour PNL quand par exemple Ademo déclare : « Il faut que je me dirige vers la Mecque mais bon je suis de la pire espèce » dans le refrain de Da (2016) .
➡ 20 ans plus tard, rien n’a changé : Koba LaD, une évolution anarchiste de la figure du vendeur de drogue
S’il n’y avait pas eu cette évolution tant au niveau du rap français que dans l’accentuation du mal être des banlieues, un album comme celui que vient de sortir Koba LaD (VII) aurait été inconcevable. En effet il aurait été impensable il y a encore quelques années de réaliser un album où l’ensemble des tracks parle des tribulations d’un jeune dealeur de drogue se revendiquant ouvertement comme tel sans jamais faire preuve d’aucun état d’âme. Contrairement à PNL qui avouent à demi-mot avoir des remords vis-à-vis de leur activité, cette fois le délire est pleinement assumé. Matrixé par The Wire et par Menace II Society, qui lui ont donné l’envie de bicrave, Koba n’hésites pas à revendiquer haut et fort que « la drogue c’est rentable » et « qu’il faut que t’en rachètes ». Comme le biz, le rap n’est plus qu’un moyen de faire de l’argent au point que si dans 3 mois il n’a pas percé il se remettra « à revendre de la C ». Tout au long de l’album, le rappeur d’evra nous explique en menus détails le mode d’emploi du bon dealeur.
À l’instar du Ten Crack Commandments de Biggie, VII est une sorte de manuel de la bicrave pour les nuls. Ainsi dans Moments durs, où il revient sur son passé de trafiquants en reconnaissant que lui aussi à connu la galère, quand il ne faisait que « 120 Euros en 2 jours », Koba semble par moment enseigner les ficelles du « métier » à un jeune motivé qui voudrait rejoindre son équipe. Du reste ce n’est pas le seul morceau où le rappeur donne des conseils aux Escobars en herbe. C’est une thématique qui parsème l’ensemble de l’album comme on peut s’en rendre compte dés les premières phases de l’introduction où il dit « ouvre grand tes yeux gamin, regarde comment on coupe la beuh, deux deux dans l’pochton d’vingt et revend à c’lui qui l’veut » ou comme sur le morceau Tout quand il affirme avoir trouvé « la faille ».
Dans Recul, comme dans son hit La C, Koba s’adresse à une amante éconduite à laquelle il explique qu’il n’a pas le temps de l’aimer parce que son business lui prend tout son temps et que son argent la seule chose qui « augmente son bien être ». Toutefois il y a des passages du morceau où c’est directement à l’auditeur qu’il semble s’adresser, pour lui expliquer que son mode de vie n’est pas un choix mais bien une fatalité (« Comment tu veux qu’j’m’habille? Comment j’mange et j’paye mon loyer ? »). En disant cela il ne fait rien d’autre que réaffirmer ce que déplorait Express D plusieurs années avant lui (« pas d’autre moyen que celui qui est si malsain, je survis au quotidien en étant vicieux et malin ») . Ainsi, bien qu’après une rapide première écoute on puisse être tenté de penser que son album est une ode à la vente de substance illicites, au final on ne peut pas dire que Koba LaD en tire une quelconque gloire puisque comme il l’affirme son train de vie n’est « pas très passionnant et un peu casse couille ». À l’opposé d’en faire l’apologie, on a plus l’impression que le rappeur a été happé par une sorte de cercle vicieux dont il est impossible de s’échapper (« plus de boloss, plus de billets, plus de billets, plus de gue-dro »).