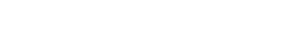En 2016, Yerim Sar prédisait la fin de la street credibility dans le rap français dans un billet publié par Vice : « La street credibility est un phénomène importé des États-Unis qui implique que le rappeur doit être un dur s’il veut être pris au sérieux. C’est évidemment idiot – un bon rappeur étant de fait un bon rappeur –, mais le concept a connu son heure de gloire ces quinze dernières années avec le phénomène dit du rap de rue. » Dans les faits, les rappeurs subissent souvent les tensions contraires de la nécessité artistique de développer un univers riche et de la recherche par une partie du public de l’authenticité. Tous ne sont pas gagnants à ce jeu, quand bien même les mensonges révélés au grand jour n’auraient pas d’impact direct sur la carrière d’un artiste, ils sont dans tous les cas susceptibles de lui porter atteinte sur le long terme. Pourtant, beaucoup s’y sont prêtés bien volontiers, peut-être du fait d’une assimilation inconsciente de ces normes, mais aussi parce que la street cred’ s’est imposée depuis des années déjà comme l’un des principaux leviers promotionnels du rap…
➡ L’angle de l’opposition, de la marginalisation marketing au marketing de marge
Pour répondre à ce paradoxe, Karim Hammou, chercheur au CNRS, utilise la notion de marketing de marge : elle désigne la façon dont un produit culturel est commercialisé auprès d’un large public sous un angle oppositionnel, porteur de revendications, de rebellions et de stigmates. Selon lui, le rap français, associé médiatiquement aux « malaise des banlieues sensibles », aurait longtemps été tenu à distance par les acteurs des industries musicales, privilégiant les stratégies commerciales consensuelles avant que la tendance ne se renverse en 1997 : la marginalisation marketing aurait cédé au marketing de la marge, où la dimension sulfureuse d’un groupe est mobilisée comme un argument commercial. De cette théorie, naît une situation complexe : il s’agit pour le rappeur de souligner l’aspect marginal de son travail, sa défiance à l’égard de sa société, voire de son incapacité à vivre dans celle-ci (« délinquant, rentre à l’heure où les oiseaux chantent », proclame Booba dans son premier album en 2002), tout en utilisant ces stigmates pour nourrir son attrait auprès du grand public.
[perfectpullquote align= »full » bordertop= »false » cite= »Booba – Bakel City Gang (2011) » link= »https://www.youtube.com/watch?v=-B8IKn-RrDc » color= »#B9121B » class= » » size= » »]Si tu l’es ap joue pas le gangster, dans la street fallait y être / Moi j’ai rien à prouver, mon casier parle en ma défaveur[/perfectpullquote]
En effet, mettre en scène ses déboires judiciaires est désormais monnaie courante, les exemples ne manquent pas : Lacrim offrant une interview à Clique depuis un mystérieux maquis que les journalistes ne gagnent qu’à la condition d’accepter de se faire bander les yeux ; Booba qui exhibe son casier dans le clip de Bakel City Gang et dont l’incarcération à Fleury est minutieusement documentée sur les réseaux sociaux quelques années plus tard ; Mister You qui sort en cavale une mixtape nommée Arrête You si tu peux ; Maes, qui popularise le hashtag #MaesEstLibérable via la mixtape Réelle Vie 2.0… L’artiste provoque avec arrogance, se drape d’insolence, et ne cesse d’affirmer l’authenticité de son expérience de la rue et de son vécu pour en faire une preuve de sa légitimité à parler de violence, dénonçant au passage les mensonges de ses rivaux. Inversement, lors des clashs entre les artistes, c’est souvent le manque de vécu qui sera raillé en priorité, ou l’existence d’un privilège dissimulé jusqu’alors, qui contredit le personnage de voyou dessiné dans les clips. Une fois leur collaboration totalement éteinte, Booba désignait publiquement Kaaris par son deuxième prénom, « Armand » – un patronyme qui devait décrédibiliser l’image de brutalité qu’arborait le rappeur.
➡ Cavales, hashtags et carnage dans les duty-free ou l’art de se donner en spectacle
Frank Freitas, docteur en sciences politiques, utilise le terme de marketing narratif afin de qualifier les situations où la performance de soi est assujettie à des visées commerciales, où l’artiste se met en scène pour vendre, quitte à ce que l’image renvoyée soit dommageable. Or, la narration et le storytelling sont précisément au cœur de l’exercice de rap, qui permet aussi de partager des histoires ou des expériences. Selon le chercheur Christian Salmon, le storytelling est également au centre des stratégies de communication contemporaines. Elle repose sur l’idée selon laquelle une marque doit s’inscrire dans un récit capable d’en faire un mythe.
[perfectpullquote align= »full » bordertop= »false » cite= »Christian Salmon – Storytelling (2018) » color= »#B9121B » class= » » size= » »]Les gens n’achètent pas des produits, mais les histoires que ces produits représentent. Pas plus qu’ils n’achètent des marques, mais les mythes et les archétypes que ces marques symbolisent.[/perfectpullquote]
Il s’agirait d’une transformation de la consommation en « distribution théâtrale », dit Salmon : « choisissez un personnage et nous fournissons les accessoires. Donnez-vous un rôle, nous nous occupons du décor et des costumes ». Comment ne pas faire de parallèle avec le game actuel ? Chacune des figures les plus médiatisées du rap pourrait être résumée en quelques adjectifs : à commencer par les deux frères de PNL, duo mystérieux, insondable, aux silhouettes sculptées, ou encore par Kalash Criminel, un homme albinos, qui ne retire jamais sa menaçante cagoule noire. Interviewé par Yérim Sar pour Noisey, Kenzy, la tête pensante du Secteur Ä, disait : « Chaque artiste est un client différent d’un autre (…) Tu fais une sorte d’audit des capacités de l’artiste : comment il peut se comporter, s’habiller, s’exprimer en public, etc. Il s’agit pas de lui inventer des qualités mais d’essayer de gommer les points négatifs, de construire ça avec lui. »
Mais qui consomme ces images et ces histoires de rue et de violence ? L’auditeur mainstream, captivé par ces images de délinquances. N’est-il pas grisant d’imaginer la banlieue comme une terre de chaos bardées de gamins armés, tout en maintenant avec elle une sage distance de sécurité ? La violence fascine, c’est une évidence. Si ce n’est pour leur affrontement à coup de flacons de parfum de luxe, pour quelle autre raison Le Figaro aurait-il parlé de Kaaris et de Booba ? Et quelles questions les journalistes de Quotidien poseraient-ils aux artistes de rap si ce n’était pas un dérivé de : vous avez eu des problèmes avec la justice récemment, n’est-ce pas ?
➡ Street cred’ ou entertainment, le difficile positionnement des artistes rap
Le risque : l’offre se trouve alors tributaire de la demande, et le storytelling est motivé par des raisons commerciales, qui conduisent à la mise en place d’un jeu de rôle. La street cred’ devient alors définitivement un argument de vente, et il s’avère d’autant plus indispensable pour les rappeurs de veiller à ce que leur mise en scène soit irréprochable, car elle facilite la commercialisation de leur musique et de leur image. Authentiques ou fictives, les expériences rapportées dans les morceaux – gérer un four, braquer une banque, égorger le moindre de ses ennemis – sont toujours présentées comme réelles, sous peine de heurter la crédibilité de l’artiste et d’affecter son public.
Plus largement, il s’agit de prendre du recul et de s’interroger : pourquoi l’acquisition de la légitimité dans le rap doit-elle passer à travers la réalité du vécu, alors que l’industrie musicale toute entière flirte de plus en plus avec l’entertainment et le spectacle ? Depuis plus d’une semaine, Booba et Kaaris planifient fiévreusement un match de MMA qui devrait les opposer à Bercy, un grand cirque qui devrait recevoir la crème du YouTube Game français, et dont Lorenzo se propose déjà d’en être le commentateur. Il est peu probable que le résultat de leur affrontement porte lumière sur leur discographie ; toutefois, il renseignera sur leur capacité à se battre, quoique cela dise de leur carrière artistique.